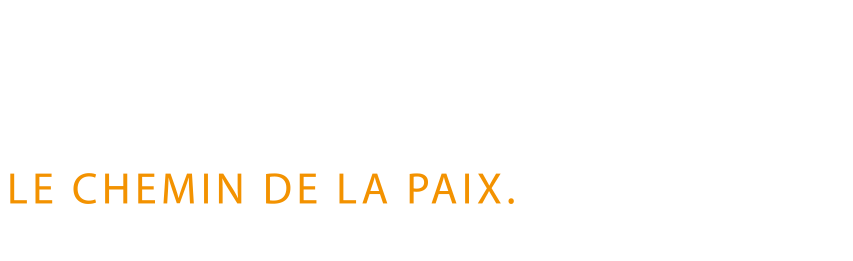(Libération) A quand la paix des Basques ?

A Bruxelles, en 1993, des militants basques manifestent pour réclamer le retour des détenus au Pays basque. (Photo Clemente Bernad. Contrasto-REA)
Quatre ans après le cessez-le-feu annoncé par l’ETA, une conférence réunissant élus, magistrats et indépendantistes s’ouvre ce jeudi à l’Assemblée nationale, à Paris. Objectif : tourner la page de la lutte armée.
«Paris n’est pas venu à nous, donc c’est nous qui venons à Paris.» Déterminé, Jean-René Etchegaray, maire centriste de Bayonne, donne le ton de la conférence humanitaire pour la paix qui s’ouvre ce jeudi au Palais-Bourbon. Paris, symbole de cet Etat si nécessaire pour clore l’un des derniers conflits d’Europe. «C’est un peu dur ce que je vais dire, mais avant on parlait de nous en mal à chaque bombe de l’ETA. Maintenant, c’est comme si nous n’existions plus.» Jean-François Lefort, dit «Lof», indépendantiste basque, fait partie des organisateurs de cette journée, qu’il espère historique.
La première conférence humanitaire pour la paix en Pays basque se déroule, dit-il avec fierté, «à l’Assemblée nationale, troisième sous-sol salle Victor-Hugo». Les organisateurs le savent, la force de l’événement réside dans la pluralité de son casting. L’ancien conseiller à Matignon et à l’Elysée Louis Joinet, l’ex-ministre de l’Intérieur Pierre Joxe, des élus centristes, socialistes, écologistes et UMP seront notamment présents. «On ne peut pas parler d’une bande d’affreux gauchistes», s’amuse le magistrat Serge Portelli. L’affiche, atypique, n’est pourtant que «la suite logique d’un processus déjà entamé» explique le président de la conférence, Louis Joinet.
Cela fait quatre ans que l’organisation séparatiste ETA a annoncé le cessez-le-feu après cinquante années d’une lutte armée qui a causé la mort de plus de 800 personnes. Une décision unilatérale prise au lendemain de la conférence internationale de Aiete. Ce 17 octobre 2011, à Saint-Sébastien, une feuille de route est établie pour entamer un processus de paix. En terre basque, une dynamique s’amorce : des élus de tous bords parlent d’une seule voix et des mouvements citoyens, comme Bake Bidea («le chemin de la paix») s’activent. Médiateurs, élus et militants sont animés par la volonté d’établir un dialogue entre l’ETA et les gouvernements espagnols et français.
La confiance vacille quand éclate l’affaire Aurore Martin. Le 1er novembre 2012, la militante du parti nationaliste Batasuna, autorisé dans l’Hexagone et interdit en Espagne, est livrée par la France à la Guardia Civil pour ses liens présumés avec ETA. Beaucoup y voient une manœuvre politique du ministre de l’Intérieur de l’époque, un certain Manuel Valls, pour contrecarrer le processus de paix.
«Cette affaire aura au moins permis de médiatiser la cause basque», reconnaît Jean-François Lefort, du parti indépendantiste Sortu (ex-Batasuna), légalisé en mai 2012 par la justice espagnole. Mais le soufflé est assez vite retombé.
Depuis, les indépendantistes tentent, tant bien que mal, de sensibiliser l’opinion publique autour du conflit basque, seul moyen, pensent-ils, d’obliger le gouvernement à agir. «C’est difficile, explique Gabi Mouesca, l’ex-prisonnier basque et ancien président de l’Observatoire international des prisons (OIP), les attaques, le sang, ça attire plus l’attention et les journalistes. Mais la résolution d’un conflit n’intéresse plus personne. La paix, c’e n’est pas très sexy.»
Des détenus en quête de droit commun
«Il y a urgence. La souffrance des familles des prisonniers est réelle. Il faut leur montrer que les choses bougent», assure Jakes Bortayrou, une figure du mouvement indépendantiste basque Abertzale. C’est l’un des enjeux essentiels aujourd’hui : avancer sur la question des prisonniers. Un peu plus de 400 sont détenus en Espagne et 96 en France. Ils sont soumis à un régime d’exception, que l’on réserve aux terroristes. Souvent incarcérés dans des prisons à l’autre bout de l’Hexagone, ils ne bénéficient pas de permis de séjour, ni des aménagements de peine prévus par le droit commun. «A terme, nous voudrions la libération de ces prisonniers politiques et, pour commencer, l’application du droit commun. La résolution du conflit doit passer par le traitement de tous les acteurs, les victimes comme les prisonniers», défend avec ferveur Gabi Mouesca, qui a passé 17 ans derrière les barreaux. Condamné à dix reprises, notamment pour un attentat contre des biens matériels et la participation à une fusillade au cours de laquelle un policier a été tué, raconte-t-il.
Sa présence jeudi est un symbole fort. «Je n’incarne rien d’original mais une réalité, les conséquences du conflit.» A l’Assemblée nationale, il devrait se retrouver nez à nez avec des victimes. «Nous allons entendre des choses difficiles mais c’est nécessaire. Le chemin de la paix passe par là», admet-t-il. Le magistrat Serge Portelli, qui s’est investi dans l’organisation de cette conférence, confirme que «ce moment promet d’être fort». «Cela ne va pas être facile mais c’est une étape importante pour avancer.»
Il a beaucoup travaillé sur la «justice transitionnelle», c’est-à-dire le rôle que peut jouer l’autorité judiciaire dans les fins de conflits. «Cela passe par les commissions de vérité et de réconciliation, où les victimes et les auteurs d’attentat sont invités à s’exprimer, comme cela s’est fait en Afrique du Sud par exemple.» Il ajoute : «Nous n’en sommes pas là encore dans la résolution du conflit basque, mais disons que c’est un point de départ.» En cinquante ans de conflit armé, les attentats de l’ETA ont provoqué la mort de plus de 800 personnes.
Le temps de rendre les armes
L’ETA a annoncé un cessez-le-feu, et de l’avis de Jean-François Lefort, président du parti indépendantiste Sortu, cette décision prise il y a quatre ans est «irrévocable». «Il n’y aura pas de retour en arrière, renchérit Gabi Mouesca, un ancien prisonnier basque, condamné notamment pour avoir participé à des attentats. Cette décision, claire, a été prise dans une démarche de résolution du conflit.»
Soit. Mais depuis 2011, les choses piétinent. Si le cessez-le-feu est respecté,l’ETA n’a pas pour autant déposé les armes. «L’ETA est prêt à aller au bout du processus mais les autorités doivent faire un geste ! Il faut se mettre autour d’une table et réfléchir aux modalités, et donner des garanties aux militants. Ils ne peuvent pas se rendre comme ça à la gendarmerie avec leurs armes sous le bras», explique Jean-François Lefort. La feuille de route établie dans la déclaration d’Aiete détaille les étapes du protocole de désarmement : mise en place d’une commission internationale de vérification du cessez-le-feu (c’est fait), inventaire et placement sous scellés des armes. «On en est là», précise Lefort.
Reste la restitution effective de l’armement. «Cela doit se faire de façon ordonnée, comme l’ont fait les Irlandais, avertit Jakes Bortayrou. Il convient notamment de nommer des observateurs neutres, et des intermédiaires officiels chargés de récupérer en toute sécurité les stocks d’armes». Il insiste, cette question du désarmement revêt une dimension politique : «le discours actuel de l’Etat français comme espagnol, c’est de dire que l’ETA a perdu et que ses militants doivent se rendre, avec leurs armes…» Fin mai, la police judiciaire de Bayonne, la sous-direction antiterroriste (SDAT) de la PJ et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en collaboration avec la guardia civil espagnole, ont déboulé dans une villa chic de Biarritz. Une dizaine d’armes et plusieurs kilos d’explosifs ont été récupérés. Un mauvais signal, quelques jours avant cette conférence parisienne, estime Louis Joinet, ancien conseiller à Matignon et à l’Elysée. «Il est certain qu’avec une opération comme celle-ci, la tendance radicale d’ETA, bien que minoritaire aujourd’hui, risque de se dire que nous sommes en train de nous faire rouler dans la farine.»
La conquête de l’opinion
L’implication du politique est le point décisif de la Conférence pour la paix au Pays basque. Pour qu’il aille de l’avant, les Etats français et espagnol doivent impérativement intégrer le processus de paix, estiment les participants à cette réunion qui se tient à l’Assemblée nationale. «C’est pour ça qu’on est à Paris», résume Anaïz Funoza, la présidente de Bake Bidea, une association pacifiste et citoyenne.
Le pari est de taille, il faut mobiliser l’opinion publique pour obliger le gouvernement à se positionner. «Ça ne doit plus être une question basco-basque mais une question basco-française et basco-européenne», souligne l’ex-prisonnier Gabriel Mouesca. Or les experts les plus modérés, à l’image de Louis Joinet, premier avocat général à la Cour de cassation et ancien conseiller pour les droits de l’homme à Matignon puis à l’Elysée, dénoncent l’inertie des gouvernements. «L’objectif de cette conférence est de faire bouger les lignes, de faire en sorte que la France et l’Espagne mettent fin à l’autisme», souligne Louis Joinet. «Sans coopération des Etats avec l’ETA, il n’y a pas de solution.» La France se voit reprocher son «suivisme» sur la question basque. Paris serait trop proche des positions du gouvernement espagnol.
Jakes Bortayrou, issu de la formation indépendantiste Abertzale, y voit un certain paradoxe : «La France a une vraie ambition diplomatique à l’international mais refuse de s’engager dans un conflit qui se déroule sur son propre territoire.» Une frilosité que ne comprend pas Jean-René Etchegaray, maire centriste de Bayonne : «L’action armée a cessé, la donne a changé, les discours aussi. Il serait grave et irresponsable que les gouvernements ne nous tendent pas la main». Si le parti populaire (PP) espagnol a longtemps usé de la menace terroriste au Pays basque comme d’un argument électoral, le conflit basque n’a jamais beaucoup pesé dans le débat politique hexagonal. Une erreur selon Max Brisson (UMP), premier vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques : «J’ai le sentiment que Madrid n’envisage qu’une victoire militaire et que la France est en phase avec le gouvernement espagnol. Or la solution ne peut être que politique.» Mobilisé sur la résolution du conflit basque depuis près de trente-cinq ans, Louis Joinet se veut néanmoins optimiste : «Pour la première fois, j’ai le sentiment que ça peut aboutir. La preuve, même les Corses commencent à trouver le processus de paix intéressant !»